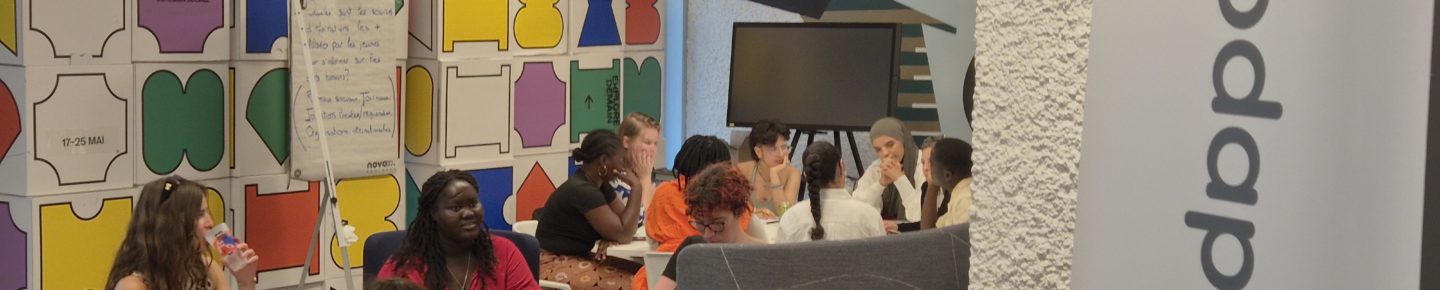
Café des Libertés 2025 : la parole aux jeunes
Synthèse de la soirée d’échange organisée par le Codap, le 11 juin 2025,
dans le cadre de sa formation annuelle, le Cod’Action plaidoyer international (CAPI)
Chaque année, le Codap organise, à Genève, une formation de 10 jours rassemblant une vingtaine de jeunes activistes pour les droits humains venant du monde entier. Cette formation vise à renforcer leurs compétences en droit international des droits humains, en gestion de projet et en plaidoyer international, notamment à travers la présentation des différents mécanismes de protection de l’ONU. En 2025, cette formation, appelée Cod’Action plaidoyer international (CAPI), s’est tenue du 4 au 14 juin, au Centre des Pérouses de Satigny.
Afin de profiter de la présence de ces défenseur·se·x·s des droits humains à Genève, le Codap a organisé une soirée d’échange sur l’engagement des jeunes à travers le monde. Cet événement avait pour objectif de rassembler des jeunes venant de différentes régions et évoluant dans des contextes distincts afin de discuter de thématiques touchant aux droits fondamentaux. Cet article synthétise les débats de la soirée afin de donner un aperçu – non exhaustif – de la mobilisation actuelle des jeunes en faveur des droits humains.
La soirée s’est déroulée à l’Espace 3DD de la Jonction, le 11 juin 2025, de 18h30 à 21h et a rassemblé 32 jeunes venant de 13 pays : L’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Bolivie, la Côte d’Ivoire, la France, le Maroc, le Mali, le Sénégal, la Suisse, la Syrie, le Togo et la Turquie. Deux bénévoles ont assisté l’équipe du Codap dans l’organisation et le déroulement de ce Café des Libertés. Après un rapide mot de bienvenue et de présentation de la part de la Co-Directrice du Codap, l’assemblée a été divisée en 5 groupes de discussion. Chaque groupe, accompagné par une modératrice, disposait d’une heure pour aborder les trois questions choisies par les organisatrices. Une restitution a ensuite été faite en plénière et a permis la poursuite des échanges. La synthèse des discussions se trouve ci-dessous, en fonction de chaque question abordée.
Question n°1 : Quelles sont les thématiques liées aux droits humains qui mobilisent particulièrement les jeunes aujourd’hui ?
Lors de la restitution en plénière des discussions par groupe, une forte convergence est apparue autour de certaines thématiques majeures de défense des droits humains. Les thématiques transversales citées unanimement comme prioritaires, quel que soit l’origine géographique des jeunes, sont les suivantes :
Droits des enfants : les jeunes s’alarment du sort des enfants face aux violences (guerres, travail forcé, incarcérations, danger du numérique), à la privation d’éducation et à la pauvreté, notamment en Afrique de l’Ouest et dans les contextes de conflits (Syrie, Palestine, etc.).
Droits de femmes et égalité de genre : ce thème est particulièrement mobilisateur dans toutes les régions, qu’il s’agisse de l’accès à l’éducation, de la lutte contre les mariages forcés, de l’accès à la terre, de la participation politique, de l’égalité salariale ou encore de la santé sexuelle et reproductive. Les activistes insistent sur le besoin d’autonomisation des femmes, notamment dans les zones rurales et les contextes de guerre. Les droits sexuels et reproductifs sont également cités par de nombreux·ses jeunes comme étant des thématiques d’actualité très importantes. Celles et ceux venant d’Afrique de l’Ouest insistent notamment sur l’importance du droit à l’avortement et de la promotion de la santé menstruelle dans les écoles.
Justice climatique et droits environnementaux : Les changements climatiques sont une préoccupation centrale pour la jeunesse mondiale sensibilisée aux questions touchant aux droits humains. Les jeunes de l’assemblée dénoncent l’impact direct de la dégradation de l’environnement sur les droits fondamentaux tels que le droit à la santé, le droit au logement ou encore à l’accès à l’eau.
Droits des minorités sexuelles et de genre (LGBTQI+) : Fortement présents dans les discours des jeunes activistes, ces droits restent pourtant contestés ou criminalisés dans certains pays représentés lors de cette soirée. Les jeunes revendiquent notamment une plus grande protection juridique et sociale ainsi que plus de visibilité pour les minorités sexuelles et de genre.
Participation politique des jeunes et des femmes : L’exclusion des ces groupes des espaces de décision est dénoncée comme un obstacle majeur à la démocratie. La méfiance de la jeunesse envers les institutions est très marquée, notamment en Afrique francophone, au Maroc, en France ou encore en Syrie.
En parallèle, des différences régionales éclairent les priorités spécifiques liées aux contextes politiques, sociaux et culturels. Les participant·e·x·s venant d’Afrique ont abordé les violences liées aux conflits armés et au terrorisme comme étant une source majeure de violations des droits humains et de préoccupation des jeunes. L’accès à la terre des femmes est également une priorité qui ressort beaucoup dans ce contexte géographique. Au Moyen-Orient, les guerres sont une préoccupation constante de la jeunesse, notamment dans le contexte actuel du génocide à Gaza et des violations des droits humains perpétrées contre toute une population. En Europe, la mobilisation pour les causes internationales a également été citée comme étant très importante. En Suisse et en France notamment, une partie de la jeunesse s’implique particulièrement dans la défense des droits à l’échelle globale (libération de la Palestine, droits des Ouïgours, protection de l’environnement, etc.), et ce du fait d’une situation plus stable sur le plan national.
Question n°2 : Quels sont les moyens d’action privilégiés par les jeunes pour s’engager en faveur des droits humains ?
Après avoir abordé les thématiques qui mobilisent principalement la jeunesse actuellement, les groupes ont discuté des moyens d’action qu’ils·elles privilégient pour faire avancer les causes qu’ils·elles défendent.
- Réseaux sociaux et campagnes digitales :
Moyen le plus fréquemment mentionné dans les groupes, les réseaux sociaux sont massivement utilisés par les jeunes pour sensibiliser, mobiliser, dénoncer et créer des communautés d’action. Les plateformes les plus citées sont Facebook (dominant en Afrique de l’Ouest), Instagram, X et Tik Tok (notamment en Europe). Sur ces réseaux, les jeunes postent des vidéos, relaient des informations ou encore créent des campagnes de sensibilisation. Dans certains pays où les manifestations sont fortement restreintes, l’utilisation des réseaux sociaux est parfois considérée comme une alternative d’engagement.
- Sensibilisation et éducation populaire :
Diverses activités de sensibilisation et de renforcement des connaissances sont utilisées à travers le monde pour mettre en avant les droits humains et permettre à celles et ceux qui sont victimes de violation de pouvoir se défendre ou, du moins, de connaître leurs droits. Certaines de ces actions sont des moments de discussions et de débats organisés autour d’un sujet spécifique. Elles peuvent prendre différents noms, selon le pays où elles sont organisées : causeries éducatives, thé-débats, cafés des libertés, etc. D’autres actions ont été citées comme l’organisation d’ateliers dans l’espace public, la tenue de stands d’information, la distribution de flyers ou encore l’organisation d’expositions ou d’autres prestations artistiques. L’art a, en effet, été cité comme un outil privilégié pour sensibiliser de manière indirecte et mobiliser émotionnellement le public. C’est un outil qui est particulièrement utilisé lorsque la liberté d’expression est restreinte.
- Engagement associatif et collectif :
S’impliquer dans une organisation non gouvernementale, rejoindre une association locale ou créer un collectif sont des moyens d’action qui ont été décrits par de nombreux·ses jeunes comme étant efficaces et largement utilisés. Rejoindre un tel organisme permet de structurer son action, de s’entourer de personnes qui œuvrent pour la même cause et de découvrir de nouvelles possibilités d’engagement.
- Manifestations et actions de rue
La manifestation est un moyen d’expression direct mais inégalement accessible selon les pays. Certaines personnes venant de Suisse, de France et de Turquie notamment, ont mentionné ce type d’action comme étant largement répandu dans leur pays. A contrario, la majorité des personnes venant d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique du Sud ont fait état de la difficulté de manifester dans leur contexte respectif. D’autres actions de rue ont été mentionnées comme les pétitions, largement répandues, notamment celles organisées par des organisations de la société civile telles qu’Amnesty International. En Suisse, le référendum a été mentionné comme un moyen d’action accessible pour la population. Au Bénin, la pratique des recours juridiques auprès de la Cour constitutionnelle est également un moyen d’action utilisé par certain·e·x·s jeunes.
Question n°3 : Quelles sont les sources d’information les plus utilisées par les jeunes pour s’informer sur les droits humains ?
- Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont le canal le plus utilisé par les jeunes pour s’informer sur la situation des droits humains à travers le monde. Les plateformes principalement citées sont :
- – Facebook : très répandu en Afrique de l’Ouest ;
- – Instagram, X, Tik Tok : largement répandu mais privilégié en Europe et chez les jeunes les plus connecté·e·x·s ;
- – Whatsapp & Telegram : très utilisé, notamment pour envoyer des informations audios (contexte d’analphabétisme ou de faible littératie).
Les réseaux sociaux sont utilisés pour suivre des comptes militants ou d’influenceur·se·x·s engagé·e·x·s, pour partager du contenu tel que des vidéos d’information, des témoignages, des statistiques, ou encore pour créer des communautés virtuelles d’information et de soutien. Lors des discussions, certains points d’attention ont été soulevés, tels que la prolifération des fake news, la censure, la manipulation ou encore le harcèlement en ligne. La nécessité d’être prudent·e·x a été répétée ainsi que l’importance de croiser ses sources afin de fiabiliser l’information.
- Les médias traditionnels
Moins dominants que les réseaux sociaux, les médias traditionnels ont toutefois été mentionnés à maintes reprises dans les groupes et restent une source d’information très présente. La radio et la télévision sont toujours largement utilisées en Afrique de l’Ouest, notamment dans les zones rurales ou peu connectées. La presse écrite, notamment celle accessible en ligne, est également un outil utilisé par les jeunes qui s’intéressent à l’analyse de sujets touchant aux droits humains.
- Les sites d’organisations spécialisées
Les jeunes ont également dit se référer à certaines sources d’informations spécifiquement liées aux droits humains. C’est le cas des sites d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine telles qu’Amnesty International, Human Rights Watch, ou encore des organes onusiens pour des informations précises (rapports, chiffres, communiqués, etc).
Certains freins concernant l’accès à l’information ont également été identifiés pendant les discussions :
- La censure et la répression : plusieurs jeunes ont évoqué la crainte de s’exprimer ou de relayer certaines informations en ligne par peur de représailles.
- Les normes socioculturelles : certains sujets restent tabous dans différentes régions du monde ce qui limite la circulation de l’information et ne permet pas à ces causes d’être visualisées (violences sexuelles, discrimination contre les groupes minoritaires, etc.).
- Surinformation et désinformation : le tri entre informations pertinentes et contenus falsifiés est un véritable défi, même pour les jeunes très connecté·e·x·s et conscient·e·x·s de cette problématique.
Conclusion
Cette première soirée d’échange sur l’engagement des jeunes pour les droits humains a été un réel succès. Tant les participant·e·x·s de la formation CAPI venant de l’étranger que les jeunes résidant à Genève ont apprécié ce moment de discussion et de partage. Le Café des Libertés a permis aux personnes présentes d’apprendre les unes les autres, de découvrir des contextes d’engagement différents ou encore d’envisager de nouvelles pistes d’action.
Loin d’être une image exhaustive de l’état de l’engagement des jeunes à travers le monde, cet article a pour objectif de mettre en avant les thématiques centrales qui intéressent la jeunesse actuellement. Malgré les multiples contextes, la jeunesse mondiale partage une forte volonté de changement et d’inclusion. Les jeunes activistes sont lucides sur les défis auxquels ils font face, mais restent profondément investi·e·x·s dans des luttes qui touchent autant à l’égalité et à la justice, qu’à la survie écologique et politique. Leur engagement dépasse les frontières nationales pour embrasser des causes mondiales, et appelle à une reconnaissance pleine de leur rôle d’acteur·rice·x·s du changement.
Malgré les différences régionales, une constante ressort : la volonté de se faire entendre, d’agir concrètement et de créer un changement durable. Toute l’équipe du Codap est ravie d’avoir permis à cet espace bienveillant, multiculturel et rempli d’espoir d’avoir lieu. Elle remercie également tous ses partenaires, sans qui cette soirée n’aurait pas pu être réalisée. La participation des jeunes est essentielle pour faire évoluer la société vers un avenir plus juste et respectueux. Le Codap est fier de contribuer, à son échelle, à faire des droits humains une priorité pour la jeunesse.


Photos du Café des Libertés du 11 juin 2025.